Détachant son regard des affiches du syndicat allemand Ver.di — le syndicat unifié des services — punaisées au mur de la salle de réunion, Mme Irmgard Schulz se lève soudain et prend la parole. « Au Japon, raconte-t-elle, Amazon vient de recruter des chèvres pour qu’elles broutent aux abords d’un entrepôt. L’entreprise les a badgées avec la même carte que celle que nous portons autour du cou. Tout y est : le nom, la photo, le code-barres. » Nous sommes à la réunion hebdomadaire des employés d’Amazon à Bad Hersfeld (Land de Hesse). En une image, l’ouvrière logistique vient de résumer la philosophie sociale de la multinationale de vente en ligne, qui propose au consommateur d’acheter en quelques clics et de se faire livrer sous quarante-huit heures un balai-brosse, les œuvres de Marcel Proust ou un motoculteur (1).
A travers le monde, cent mille personnes s’affairent au sein de quatre-vingt-neuf entrepôts logistiques dont la surface cumulée totalise près de sept millions de mètres carrés. En moins de deux décennies, Amazon s’est propulsé à l’avant-scène de l’économie numérique, aux côtés d’Apple, Google et Facebook. Depuis son introduction en Bourse, en 1997, son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre cent vingt, atteignant 62 milliards de dollars en 2012. Son fondateur et président-directeur général, M. Jeffrey Preston (« Jeff ») Bezos, libertarien et maniaque, inspire aux journalistes des portraits d’autant plus flatteurs qu’il a investi en août dernier 250 millions d’euros — 1 % de sa fortune personnelle — dans le rachat du vénérable quotidien américain The Washington Post. Le thème de la réussite économique éclipse à coup sûr celui des conditions de travail.
En Europe, Amazon a choisi l’Allemagne comme tête de pont. Le groupe y a implanté huit usines logistiques et en construit une neuvième. Au volant de son automobile, Mme Sonia Rudolf emprunte une avenue nommée Amazon Strasse (2) — la municipalité a subventionné l’implantation de la multinationale à hauteur de plus de 7 millions d’euros. Puis elle pointe un immense pan de tôle grise. Derrière une rangée de fils de fer barbelés, l’entrepôt surgit. « Au troisième étage de FRA-1 (3), il n’y a aucune fenêtre, aucune ouverture, et pas de climatisation, témoigne cette ex-employée. L’été, la température dépasse les 40 °C, et les malaises sont alors très fréquents. Un jour — je m’en souviendrai toute ma vie —, alors que j’étais en train de “picker” [prendre des marchandises dans les alvéoles métalliques], j’ai trouvé une fille allongée sur le sol qui vomissait. Son visage était bleu. J’ai vraiment cru qu’elle allait mourir. Comme nous n’avions pas de civière, le manager nous a demandé d’aller chercher une palette en bois sur laquelle nous l’avons allongée pour la transporter jusqu’à l’ambulance. »
Des faits similaires ont été rapportés par la presse aux Etats-Unis (4). En France, c’est le froid qui, en 2011, a frappé les salariés de l’entrepôt de Montélimar (Drôme), obligés de travailler avec parkas, gants et bonnets, jusqu’à ce qu’une douzaine d’entre eux entament une grève et obtiennent l’allumage du chauffage. C’est en partie ainsi qu’Amazon a catapulté son fondateur au dix-neuvième rang des milliardaires de la planète (5).
La spécificité du supermarché en ligne consiste à permettre à des commerçants, à travers sa plate-forme Marketplace, de proposer leurs produits à la vente sur son site, en concurrence directe avec sa propre marchandise. L’ensemble gonfle le chiffre d’affaires et accroît l’effet de « longue-traîne » — l’agrégation de multiples petits volumes de commandes pour des produits peu demandés dont le coût de stockage est faible —, à l’origine du succès de l’entreprise. Ce système, efficace pour le consommateur, enrôle les libraires dans la promotion du géant qui vampirise leur clientèle et détruit leur activité.
« Le sourire sur le colis, ce n’est pas le nôtre »
Le Syndicat de la librairie française a en effet mesuré que, à chiffre d’affaires égal, une librairie de quartier génère dix-huit fois plus d’emplois que la vente en ligne. Pour la seule année 2012, l’Association des libraires américains (American Booksellers Association, ABA) évalue à quarante-deux mille le nombre d’emplois anéantis par Amazon dans le secteur : 10 millions de dollars de chiffre d’affaires pour la multinationale représenteraient trente-trois suppressions d’emplois dans la librairie de proximité.
En outre, tout oppose les postes disparus et ceux créés dans les entrepôts logistiques. D’un côté s’évanouit un travail qualifié, diversifié, durable, situé en centre-ville, mêlant manutention, sociabilité, contact et conseil. De l’autre émergent en périphérie urbaine des « usines à vendre » où la production continue de colis en carton échoit à une main-d’œuvre non qualifiée, recrutée au seul motif qu’elle coûte actuellement moins cher que des robots. Mais plus pour longtemps : depuis son rachat en 2012, pour 775 millions de dollars, de la société de robotique Kiva Systems, Amazon prépare la mise en service dans ses entrepôts de petits automates roulants : des hexaèdres orange de trente centimètres de hauteur capables, par exemple, de se glisser sous une étagère pour déplacer des charges allant, selon les modèles, de quatre cent cinquante à mille trois cents kilos.
Il s’agit de réduire à vingt minutes seulement le délai entre le passage de la commande par le client et son expédition. M. Bezos vise un objectif devenu légendaire : proposer et vendre n’importe quelle marchandise livrée partout le jour même de la commande. Depuis ses débuts, Amazon investit des sommes pharaoniques dans des serveurs et accroît sans cesse ses capacités de calcul algorithmique afin d’améliorer l’efficacité de sa logistique et les potentialités de son site marchand. Lequel propose toujours plus de nouveaux produits à d’anciens clients, grâce à un recoupement complexe de leurs données personnelles et de leurs habitudes de consommation. Et, pour que rien ne se perde, les ressources informatiques excédentaires sont louées à des entreprises à travers un service spécifique, Amazon Web Services (6).
Quel que soit leur pays d’implantation, les entrepôts logistiques présentent une architecture et une organisation du travail similaires. Situés à proximité d’échangeurs autoroutiers, dans des zones où le taux de chômage dépasse la moyenne nationale, ils sont placés sous la garde sourcilleuse de sociétés de sécurité. Ces parallélépipèdes de tôle s’étalent sur une surface parfois supérieure à cent mille mètres carrés, soit près de quatorze terrains de football. Ils s’animent au rythme d’un ballet de poids lourds : toutes les trois minutes, le groupe Amazon gorge de colis un semi-remorque. Pour le seul territoire des Etats-Unis, l’entreprise a vendu jusqu’à trois cents articles à la seconde durant les fêtes de Noël 2012.
La profusion de produits proposés aux cent cinquante-deux millions de clients du site se matérialise dans les entrepôts abritant des forêts d’étagères métalliques où triment des ouvriers astreints au silence par le règlement intérieur. Tous, considérés comme des chapardeurs potentiels, subissent des fouilles minutieuses assurées par des vigiles : ils passent par des portiques de sécurité lors de leur sortie définitive ou de leur pause, ainsi raccourcie par ce fastidieux contrôle qui génère de longues files d’attente. Amazon refusant de placer les pointeuses des entrepôts au niveau du point de fouille, des travailleurs des centres de distribution du Kentucky, du Tennessee et de l’Etat de Washington, aux Etats-Unis, ont déjà lancé quatre poursuites judiciaires afin de lui réclamer le paiement de ce temps d’attente non rémunéré qu’ils estiment à quarante minutes par semaine.
La mutualisation et la gestion des stocks d’Amazon sont informatisées selon la logique du chaotic storage : on dispose les articles de manière aléatoire sur les rayonnages. Ce « rangement chaotique » présente l’avantage d’une plus grande flexibilité que le stockage traditionnel : inutile de prévoir des espaces supplémentaires pour chaque type d’article en cas de variations de l’offre ou de la demande, puisque tout s’entasse au hasard. Chaque rangée d’étagères compte plusieurs niveaux, chaque niveau plusieurs cellules de rangement : ce sont les bins (alvéoles), dans lesquelles les écrits d’Antonio Gramsci coudoient un paquet de slips pour homme, un ours en peluche, des condiments pour grillades ou Metropolis de Fritz Lang.
Au sein de l’unité de « réception », les ouvriers eachers (« réceptionneurs ») défont les palettes des camions et référencent la marchandise. Les stowers (« stockeurs »), eux, placent les articles là où ils peuvent sur les immenses étagères, afin de constituer un bazar seulement répertorié par un scanner Wi-Fi lecteur de codes-barres. Pour conjurer la géographie vertigineuse des kilomètres de linéaires, au milieu de cette formidable accumulation de marchandises, la technologie la plus moderne guide, contrôle et mesure la productivité de salariés accomplissant des tâches répétitives éreintantes. Dans l’unité dite de « production », les pickers (« ramasseurs »), également guidés par leur scanner, arpentent pour leur part les étagères. Afin de prélever inlassablement des articles, ils marchent plus de vingt kilomètres par prise de poste — chiffre officiel des agences d’intérim que les syndicalistes contestent, l’estimant minoré.
Dès qu’une marchandise est extraite, un compte à rebours s’affiche sur le scanner, ordonnant au travailleur de prélever la suivante. Son choix est déterminé par ordinateur afin d’optimiser la distance de parcours. Quand leur chariot roulant est plein, les pickers l’apportent aux packers (« emballeurs »). Eux sont statiques et empaquettent à la chaîne les produits, avant de pousser les colis sur d’immenses convoyeurs informatisés. Ceux-ci pèsent les cartons frappés du sourire d’Amazon, collent les adresses, puis les répartissent selon les services postaux ou transporteurs internationaux.
« Le sourire sur le colis, ce n’est pas le nôtre », lance M. Jens Brumma, 38 ans, stower depuis 2003. Ayant alterné chômage et missions d’intérim chez Amazon pendant sept ans, il y enchaîne depuis 2010 des contrats courts, car la direction refuse de le titulariser. Comme à chaque salarié dans le monde, ses contrats lui interdisent strictement de s’exprimer à propos de son emploi auprès de sa famille, de ses amis ou de journalistes. « Le silence qu’on nous impose, précise-t-il, ce n’est pas pour protéger des secrets industriels, auxquels nous n’avons pas accès : c’est pour taire l’extrême pénibilité de nos conditions de travail. »
En fin d’année, lors de la période de pointe dite « Q 4 » — quatrième trimestre —, des équipes de nuit sont constituées, et chaque entrepôt a massivement recours à une main-d’œuvre intérimaire afin d’expédier les commandes des fêtes. « Durant cette période », explique M. Heiner Reimann, l’un des permanents spécialisés détachés par Ver.di en 2010 afin d’implanter et d’accompagner une action syndicale, « le nombre de travailleurs passe brusquement de trois mille pour les deux entrepôts à plus de huit mille. Des intérimaires en provenance de toute l’Europe arrivent à Bad Hersfeld, et sont logés dans des conditions terribles. Ici, pour traiter ces milliers de contrats intérimaires, Amazon a embauché des secrétaires chinoises. L’an dernier, elles travaillaient dans une grande salle vide, sans meubles, et empilaient les contrats à même le sol, un à un. C’était surréaliste. » Chômeurs espagnols, grecs, polonais, ukrainiens, portugais convergent en autocar des quatre coins de l’Europe, enrôlés par des agences d’intérim.
« Les managers vantent ce recrutement international et l’affichent comme un motif de fierté, témoigne M. Brumma. Lors d’une fête organisée par l’entreprise, on m’a demandé d’accrocher les drapeaux de toutes les nationalités présentes : il y en avait quarante-quatre ! Les Espagnols étaient les plus nombreux. Parmi eux se trouvaient des gens très diplômés : un historien, des sociologues, des dentistes, des avocats, des médecins. Ils sont au chômage, alors ils viennent ici le temps d’une mission d’intérim. »
Hard-rock à plein volume pendant le travail
L’Allemand Norbert Faltin, ex-cadre dans l’informatique brusquement licencié en 2010, a dû accepter de devenir du jour au lendemain ouvrier picker intérimaire à Bad Hersfeld. « En plein hiver, j’ai logé pendant trois mois avec cinq étrangers dans un bungalow normalement utilisé par des estivants, et qui n’était donc pas équipé de chauffage. Je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie. Nous étions tous des adultes et nous dormions à tour de rôle dans le lit pour enfant. » Ici, l’éventuelle signature d’un contrat à durée indéterminée marque l’aboutissement d’une succession de contrats courts pendant laquelle il n’est guère prudent de se syndiquer, ni a fortiori de faire grève. Et le recours massif à une main-d’œuvre intérimaire immigrée avant les fêtes de Noël contrecarre l’effet des grèves lancées par Ver.di pendant ce dernier trimestre où Amazon, pour une fois vulnérable, réalise 70 % de son chiffre d’affaires annuel.
Afin d’honorer sa devise, « Work Hard, Have Fun, Make History » (« Travaille dur, amuse-toi, écris l’histoire »), placardée dans tous ses ateliers sur la planète, le géant américain encadre ses employés par une technique de management extrêmement rigoureuse, le « 5 S », inspiré des usines automobiles japonaises, et organise de multiples événements paternalistes, tant durant le travail qu’en dehors. « Au moment du “Q4”, les managers diffusent de la musique à plein volume dans l’entrepôt pour nous exciter, raconte Mme Rudolf. Un jour, pendant les fêtes, ils nous avaient mis du hard-rock pour nous faire travailler plus vite. C’était tellement fort que j’en avais mal à la tête, cela me donnait des palpitations. Quand j’ai demandé au manager de baisser le volume, il s’est moqué de moi parce que j’avais plus de 50 ans, en me disant qu’ici nous étions une entreprise de jeunes. Moi, j’étais senior, et on me demandait d’avoir la même productivité au picking qu’un jeune de 25 ans. Mais après le décès de mon mari, je n’avais pas le choix, il me fallait accepter ce travail. »
Des cadres qui se filment singeant des syndicalistes
Les ouvriers de Bad Hersfeld se souviennent d’avoir vu M. Bezos lors de l’inauguration du premier entrepôt allemand de la société, à l’été 2000. Ce jour-là, leur patron, venu spécialement des Etats-Unis, avait fait atterrir son hélicoptère sur le parking des employés afin d’apposer ses mains enduites de peinture sur une plaque. « Tout est dit et écrit en anglais chez Amazon. Les salariés y sont appelés les “hands”, les petites mains, explique Mme Schulz. Jeff Bezos nous avait montré ses mains en disant au micro que nous étions tous des hands, comme lui, et que nous étions ses associés, car nous avons droit à des actions après plusieurs années dans l’entreprise. A l’époque, il nous avait expliqué que nous formions une grande famille. Après ça, il appelait même parfois au téléphone, et sa voix était diffusée par haut-parleur dans l’entrepôt pour nous parler, pour nous stimuler. Et ça marchait. Amazon, nous en étions fiers ; c’était pour nous le rêve américain. Mais c’est vite devenu un cauchemar. C’est pour cela qu’aujourd’hui je participe aux grèves. »
Longeant une table où s’amoncellent tracts, badges, documentation juridique surlignée et coupures de presse évoquant la dernière grève, les membres de l’équipe de l’après-midi quittent promptement leurs chaises pour aller pointer. « C’était très difficile quand je suis arrivé. Les travailleurs étaient terrorisés à l’idée de nous parler ou d’accepter nos tracts », confie le syndicaliste Reimann, en attendant l’arrivée de l’équipe du matin pour animer une seconde réunion. Après plus d’une décennie chez Ikea et une solide formation en droit social, il a débuté cette mission pour Ver.di en 2010. Constatant la dépolitisation et l’absence de culture syndicale de la plupart des employés d’Amazon, il s’adapte à la situation et parvient peu à peu à des résultats grâce à des actions organisées à partir d’un noyau dur.
Dès 2011, les militants collent par exemple de petites feuilles de papier autoadhésives colorées partout dans les entrepôts allemands. Sur chacune d’elles, une question anonyme pointe une entrave au droit du travail, une injustice ou une dérive. Les exemples sont toujours choisis par les travailleurs eux-mêmes, qui les font rédiger par leurs proches pour qu’on ne puisse pas reconnaître leur écriture. Ces feuilles, apposées par milliers sur le lieu de travail sans causer de dégradations, sèment la panique parmi les managers. Au terme des délibérations tenues lors de réunions hebdomadaires ouvertes à tous, des revendications émergent rapidement depuis Bad Hersfeld et Leipzig (Land de Saxe).
A Leipzig, personne n’est payé au tarif de branche négocié par Ver.di pour la distribution. Alors que les conventions salariales des Länder de l’Est prévoient un salaire minimum de 10,66 euros de l’heure, Amazon applique sa propre grille : 9,30 euros. A Bad Hersfeld, même décalage entre le tarif de branche (12,18 euros de l’heure) et le salaire de cet entrepôt : 9,83 euros. Deux ans et demi après les premières réunions Ver.di, près de six cents salariés allemands tiennent régulièrement des piquets de grève afin d’exiger l’application de la convention collective (Tarifvertrag) du secteur. A tel point que les syndicalistes et leurs sympathisants portent désormais ostensiblement, y compris au travail, un petit bracelet rouge avec les mots « Work Hard, Have Fun, Make Tarifvertrag ».
Le résultat ? Mme Rudolf le constate d’elle-même lorsqu’elle rencontre d’anciens collègues en se baladant dans le centre-ville de Bad Hersfeld : « L’image du syndicat a beaucoup changé. Les gens ont de moins en moins peur de se syndiquer, et cela devient presque un réflexe pour eux quand ils subissent une humiliation. Ils veulent riposter pour défendre leurs droits et leur dignité. »
En France, le 10 juin 2013, une centaine de salariés de l’entrepôt de Saran (Loiret) étaient également en grève à l’appel de la Confédération générale du travail (CGT). Tous ont été convoqués individuellement le lendemain. « Parce que je suis syndicaliste, j’ai été soumis à des fouilles arbitraires durant mon temps de travail, témoigne M. Clément Jamin, de la CGT. Je les ai refusées ; on m’a alors demandé de m’asseoir sur une chaise, soi-disant le temps que la police arrive. Je suis resté assis six heures devant tout le monde, et la police n’est jamais venue. Ils ont essayé de me faire le même coup le lendemain et le surlendemain. La CGT a déposé plainte. » Hostiles aux syndicats, les cadres d’Amazon s’emploient également à les humilier. Récemment, dans une vidéo parodique interne que nous avons pu visionner, deux cadres des ressources humaines de Saran se sont filmés singeant des syndicalistes et arborant un drapeau de la CGT.
« Les cadences sont épuisantes, confie d’un ton grave Mohamed, ouvrier à Saran, qui a réclamé l’anonymat. Et en contrepartie, qu’est-ce qu’on nous propose ? Du “have fun” : des tombolas pendant les pauses, des distributions de chocolats, de bonbons… Mais moi, je n’arrive pas à adhérer à l’idée de venir décharger des camions déguisé en clown. » En effet, selon les thèmes choisis par les managers, les salariés sont régulièrement invités à venir pointer costumés en sorcières ou en basketteurs. « Pendant ce temps, notre productivité reste bien sûr enregistrée par informatique, poursuit-il. On nous demande d’être des “top-performers”, de nous surpasser, de battre sans cesse nos records de productivité. Depuis le mois de juin 2013, les managers nous font même faire collectivement des échauffements et des étirements avant nos prises de poste. »
« Les intérimaires sont traités comme de la viande »
Chose inouïe, le règlement intérieur impose que la productivité individuelle soit en hausse constante. L’enregistrement en temps réel de la performance des travailleurs permet aux contremaîtres de les géolocaliser à tout moment dans l’entrepôt, d’obtenir courbes et historique de leur rendement, mais aussi d’organiser leur mise en concurrence. M. Reimann a récemment découvert que cette mesure, « qui est une donnée personnelle, est envoyée chaque jour par informatique depuis les entrepôts allemands à Seattle, aux Etats-Unis, où elle est stockée. C’est tout à fait illégal ! ». Un ancien manager d’Amazon en France ayant suivi les formations internes au Luxembourg confirme cette pratique que les ouvriers ignorent : « Toutes leurs données de productivité sont enregistrées, centralisées à la seconde par informatique, puis envoyées à Seattle. »
Si les employés sont mis en concurrence, la sémantique maison les invite également à « signaler des anomalies ». « Cela peut être un carton qui bouche une entrée, explique Mohamed. Mais cela peut aussi être un collègue en train de discuter. Il faut alors le dénoncer. C’est bien vu pour monter en grade et devenir lead, contremaître. » « Un jour, se remémore M. Sihamdi, à un collègue qui m’interrogeait sur la fortune de Jeff Bezos, j’ai répondu que cela me donnait envie de vomir. Il m’a dénoncé, et j’ai été rappelé à l’ordre pour avoir critiqué l’“esprit Amazon” ! L’ambiance de travail est délétère ; tout le monde se surveille. Et les intérimaires sont traités comme de la viande, ce qui m’était insupportable. Je connais bien le monde industriel, notamment celui de l’automobile. Mais mon expérience chez Amazon est de très loin la plus violente de ma carrière d’ingénieur. »
Chutes, malaises, doigts coupés sur le convoyeur, syndromes d’épuisement : les accidents du travail sont nombreux chez Amazon. La presse préfère cependant commenter élogieusement les performances boursières de la multinationale, les frasques de son fondateur ou la construction de nouveaux entrepôts logistiques — les cinq unités bientôt installées en Pologne et en République tchèque pesant d’ailleurs comme une menace de dumping salarial sur les travailleurs allemands. Elle vante la création d’emplois précaires et invisibles qui viendront en détruire davantage dans le commerce de proximité.
Soutien des grèves menées par Ver.di, le journaliste allemand Günter Wallraff suit avec attention le développement fulgurant d’Amazon. Depuis Cologne, il raconte avoir lui-même tenté un bras de fer avec le mastodonte du commerce en ligne : « Quand j’ai découvert les conditions de travail de ses ouvriers, j’ai immédiatement appelé au boycott et demandé à mon éditeur de retirer mes livres du site. Cela lui a posé problème : Amazon représente 15 % de ses ventes. Après avoir débattu de l’idée, la maison d’édition s’est néanmoins alignée sur mon exigence. Mais, désormais, Amazon se fournit chez des grossistes pour continuer de vendre mes livres ! Et cela, je ne peux malheureusement pas l’empêcher. Je suis donc critiqué par des gens qui me disent : “Tu fais de beaux discours, mais tes livres continuent d’être vendus sur Amazon”… En réalité, on ne peut pas combattre cette entreprise individuellement. C’est une multinationale organisée selon une idéologie bien définie. Son système ne nous pose pas la simple question, neutre, de savoir si nous voulons ou non consommer sur son site Internet ; il nous pose des questions politiques : celles de notre choix de société. »









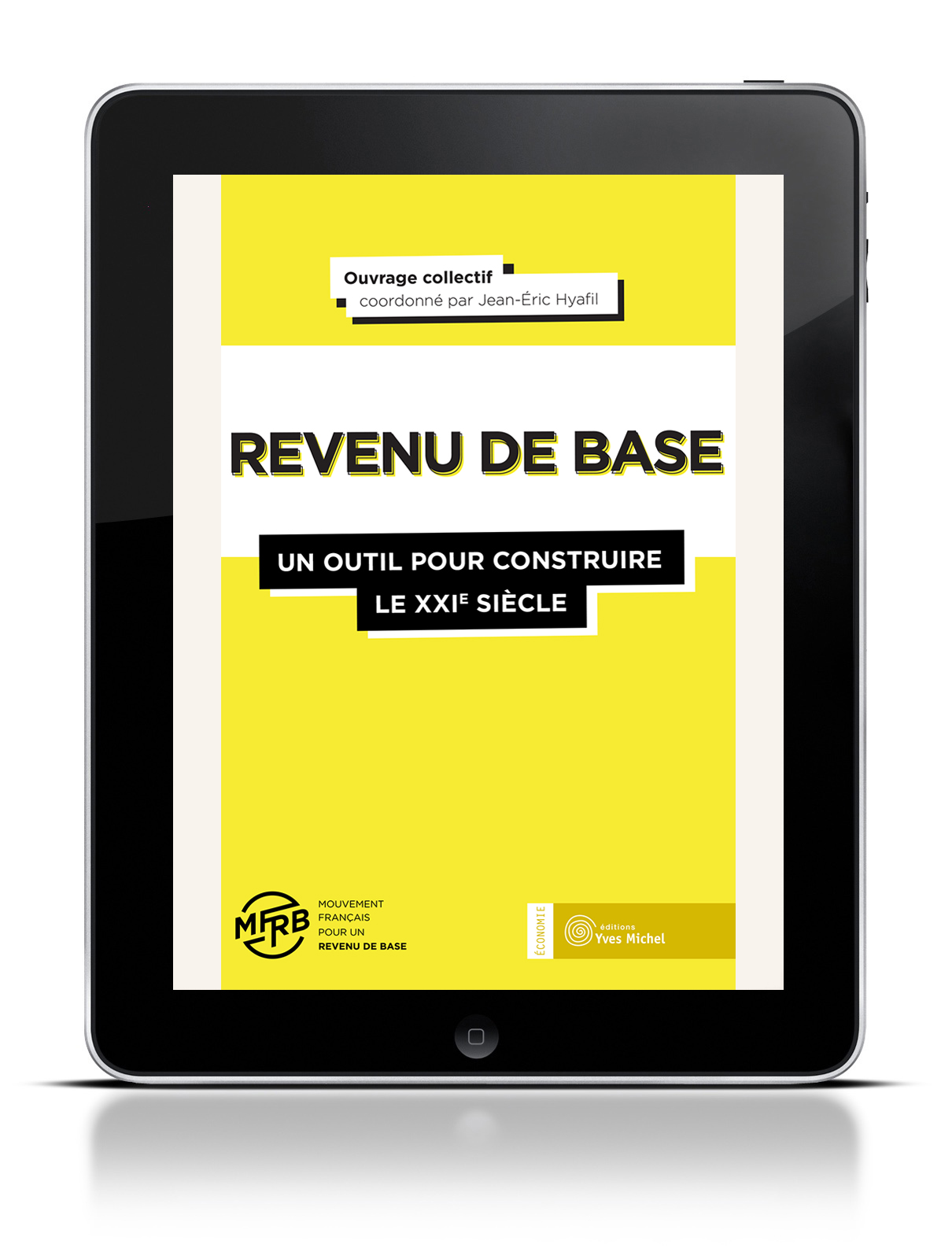
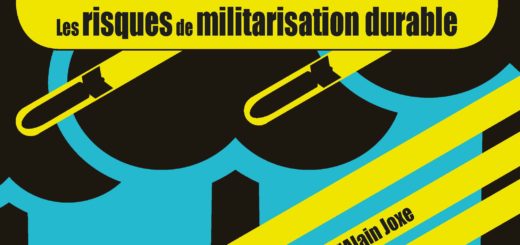


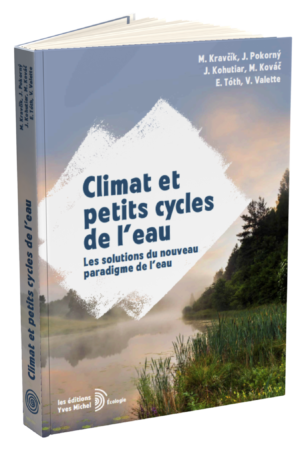
Commentaires récents