
Tout ce temps à se chercher, à se fuir, se retrouver, se découvrir, se reconnaître, se jurer fidélité, se trahir, se battre contre les démons d’une déliquescence ontologique.
Tant d’années d’agitation, entre exaltations et macérations, à escamoter la confiante indépendance de son sexe creux pas coupable derrière les parades et propagandes phalliques, à mendier amour et compliment à des matraques, à se mirer dans le regard des sans-âme, dans le reflet des couteaux.
Décennies en montagnes russes, ponctuées d’angoisses, à se méfier, se berner, se tourmenter, compenser et sublimer, des temps morts à s’oublier, se détourner, s’abîmer, s’écarteler entre inconciliables, des temps rageurs à se détester, s’accuser, se mortifier, se rebeller, se cuirasser, et puis, après avoir hurlé aux charniers des innocents, renaître de ses cendres et comprendre que ça ne s’arrêtera jamais jusqu’à ce qu’on y laisse sa peau…
Tout ce temps perdu à se morfondre, se justifier, se verbaliser, se disculper, se blanchir, à refouler intrusions et invasions, à balayer la carpette d’indésirables ou déplier le tapis rouge, à compter les maillons de ses chaines et aiguiser la lime cachée sous le lit, tous ces combats contre ses conditionnements, ces défis contre des moulins à vent, pour des révolutions idéales et des causes incontournables, tout ce bois à enfourner dans l’athanor en croyant obtenir de l’or, et puis, un jour totalement improbable, un petit temps égaré lors d’une échappée, à s’affaler sur l’herbe hors du sentier tracé, à retrouver son souffle et découvrir autour, pas gâchées, une fleur, une coccinelle.
S’offrir alors du temps à grappiller une once de bonheur sur ces coteaux sauvages, loin des loupes et des notes, et enfin, finalement, près de la ligne d’arrivée, sur le bord de la piste où on campe parce qu’on a crevé, un jour sans challenge et sans performance, un jour sans chaud ni froid, ni doux ni dur, loin des miroirs et des micros, une après-midi banale au fond d’un coin perdu, aboutir à un seul instant, un tout petit instant, comme une virgule, comme un soupir sur la partition, un instant hors du temps, un instant de silence.
Suspendu. Creux. Vide.
Et franchir un cap d’éternité. A cause de ce silence. De ce qu’on pressent de ce silence. Une immensité radieuse. Là, on n’entend plus ce qu’il faut, ce qu’il aurait fallu et ce qu’il faudrait, plus de semonces, menaces et objurgations, plus de fils d’actualités ni de débats démocratiques, plus de mythes à embobiner pour exister, plus de productions à fournir au système pour sa rémunération ni à ma mère pour qu’elle m’aime, plus de rôles à jouer, de scènes à dramatiser, de dominants à séduire, dédaigner ou tromper, d’étrangers et d’exclus à plaindre et secourir, plus d’indignations ni de plans sur la comète, même plus de romances et de bons sentiments, juste rien de connu.
Suspendu. Creux. Vide. Extraordinaire.
Un tout petit instant détaché de la masse, une goutte d’eau transparente jaillie sur la crête d’un flot, qui comprend, en voyant la mer à l’infini, que le vent de surface n’a aucun pouvoir sur l’abyssal silence des profondeurs.
Pourtant, il n’y a pas rien dans ce qui arrive à cet instant. C’est autre chose. Je ne sais pas ce que c’est, matière ou éther, prémonition, vision, perception ou illumination.
C’est une sorte de voyage à l’envers, un retour d’exil.
Je parle arbitrairement d’années, parce que c’est difficile de ne pas mettre des limites temporelles à ce retournement, parce que la réalité physique et sociale se conjuguent à un moment de la vie avec la conscience aiguë d’avoir saisi la chance de sa génération, la possibilité d’échapper à l’esclavage.
Dans ce silence, le temps est aboli, suspendu, creux sans fond qui n’a pourtant rien d’une perdition, plutôt une sorte d’écho subtil s’évanouissant à l’infini en ricochant sur les étoiles d’atomes, ondulant d’un calme placentaire qui fait pousser des ailes, parce qu’on est certain tout à coup de retrouver son chemin, le chemin de la maison, qui est pour certaines, fées quotidiennes, et pour certains, pas vilains, le chemin du mandala habité, le chemin de la yourte.
J’ai pu m’abstraire de la coupe d’un mari, de la férule d’un patron, des affiliations d’église ou de partis, j’ai pu être pauvre sans être misérable, socialisée sans être aliénée, j’ai produit sans modèles, sans brevets et sans prostitution, j’ai pu m’abriter, me nourrir, me vêtir et me soigner sans dévaliser la planète, et je suis probablement une des dernières à pouvoir habiter la forêt, ce qui me vaut cette sensation, en regardant à rebours, d’être passée entre les mailles du filet, toujours de justesse. Au fil du rasoir. Comme ce soldat rescapé d’un massacre au dernier jour de la guerre. On ne m’a pas coupé la tête quand j’ai dû avorter, j’ai pu tenter une vie d’artiste quand la loi contre l’exclusion a été votée, j’ai fabriqué et posé ma yourte dans le bocage de France avant que soient instituées des réserves de sauvages, des ghettos pour contenir cette étrange horde barbare d’irréductibles improductifs qui croient encore aux esprits de la nature, je n’ai pas été brulée pour avoir défendu l’ortie et le pissenlit et je n’ai pas été vitriolée parce que je suis une femme. J’ai pu éprouver et m’installer dans la singularité de préférer l’Être à l’Avoir, cultiver la différence par une certaine distance, bien que souvent dans la fuite et la grande précarité, mais dans un contexte où la solitude et la liberté d’une femme, même vilipendées et méprisées par la meute mâle, ne sont pas interdites et punies par la loi ou les kalachnikovs. De cette grande chance ont pu naître des temps sans prescriptions, que la plupart utilisent en divertissements (quel gâchis…), dont j’ai fait des enclaves d’expérimentation, de réflexion et de méditation en dehors de tout embrigadement. C’est grâce à la gratuité de ces temps là, qui m’ont rapprochée des arbres et de la beauté, résistance farouche à l’effondrement du sens et de la nature, que lentement s’est préparé cet instant de grâce où le silence émerge comme une vérité absolue.
Ensuite, on le perd de vue, les tiraillements reviennent, car rien, et surtout pas l’éveil, n’est jamais acquis. Mais une fois que, sur la crête d’un instant immobile, on l’a rencontré, on sait l’origine et la perpétuité et on n’a plus peur. Si on veut le programmer, le faire revenir de force, il s’échappe. Il est totalement autre et totalement Soi, insaisissable et impossible à manipuler, à contrôler, sans suprématie et sans démonstration de puissance, et pourtant totalement pénétrant. Plus il est là et plus on devient vrai, transparent et miraculeusement ignorant, une absence de savoir et de jugement parfaitement reposante, une absence qui imprègne et relie à l’ensemble du vivant, avec une communication sans mots, qui plonge aux racines de tout ce qui respire.
Alors, au sein de cette vacuité, dans une tranquillité furtive, fugitive mais indélébile, je sais que j’en suis, que j’y étais déjà et que j’y serais toujours.




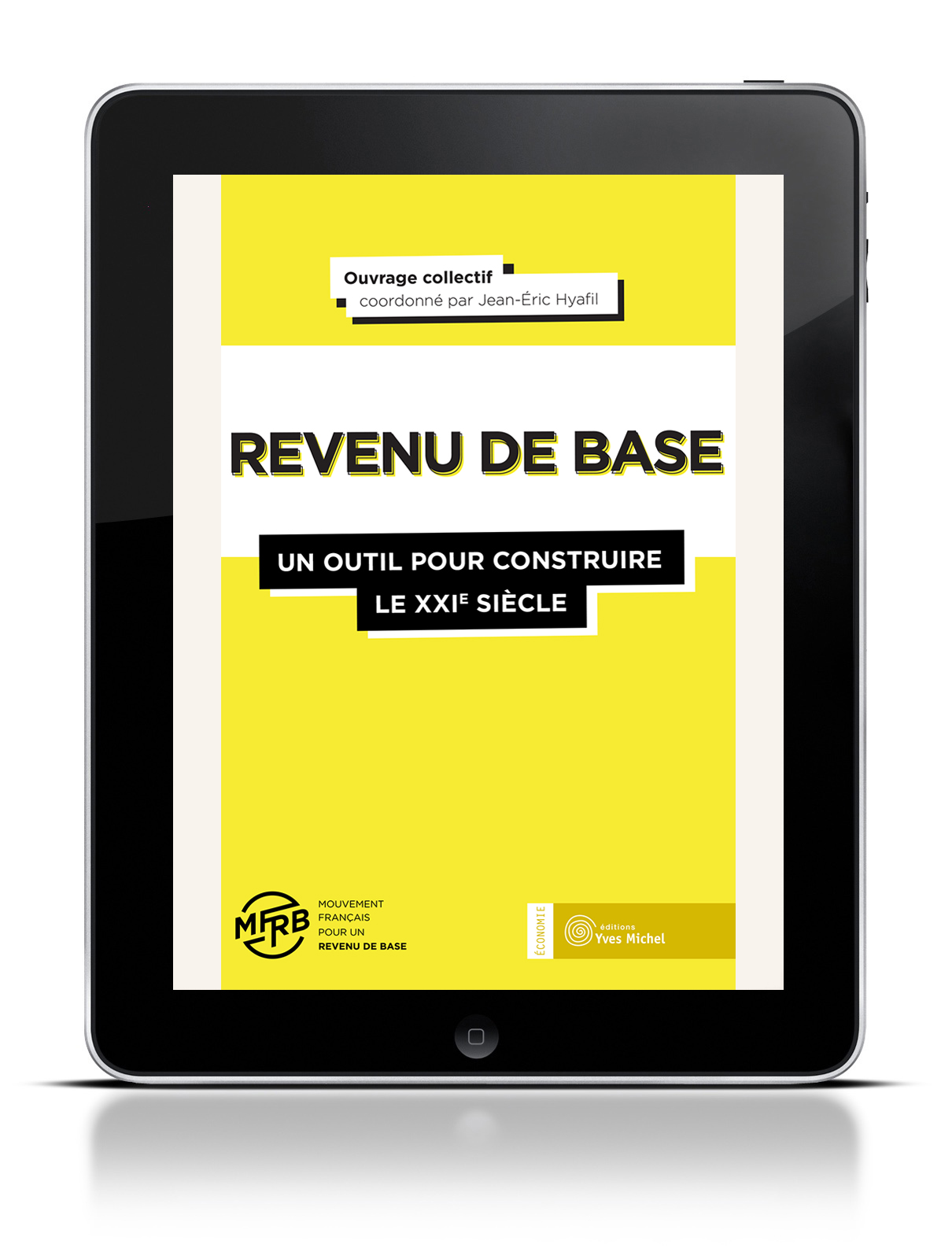
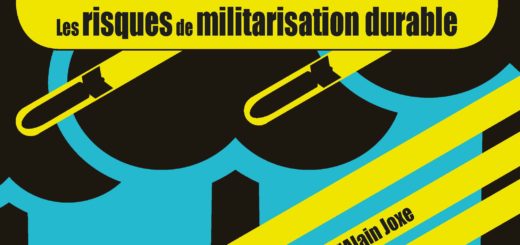


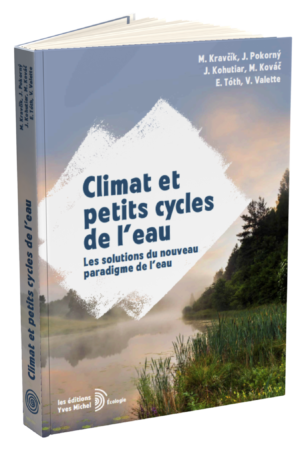
Commentaires récents